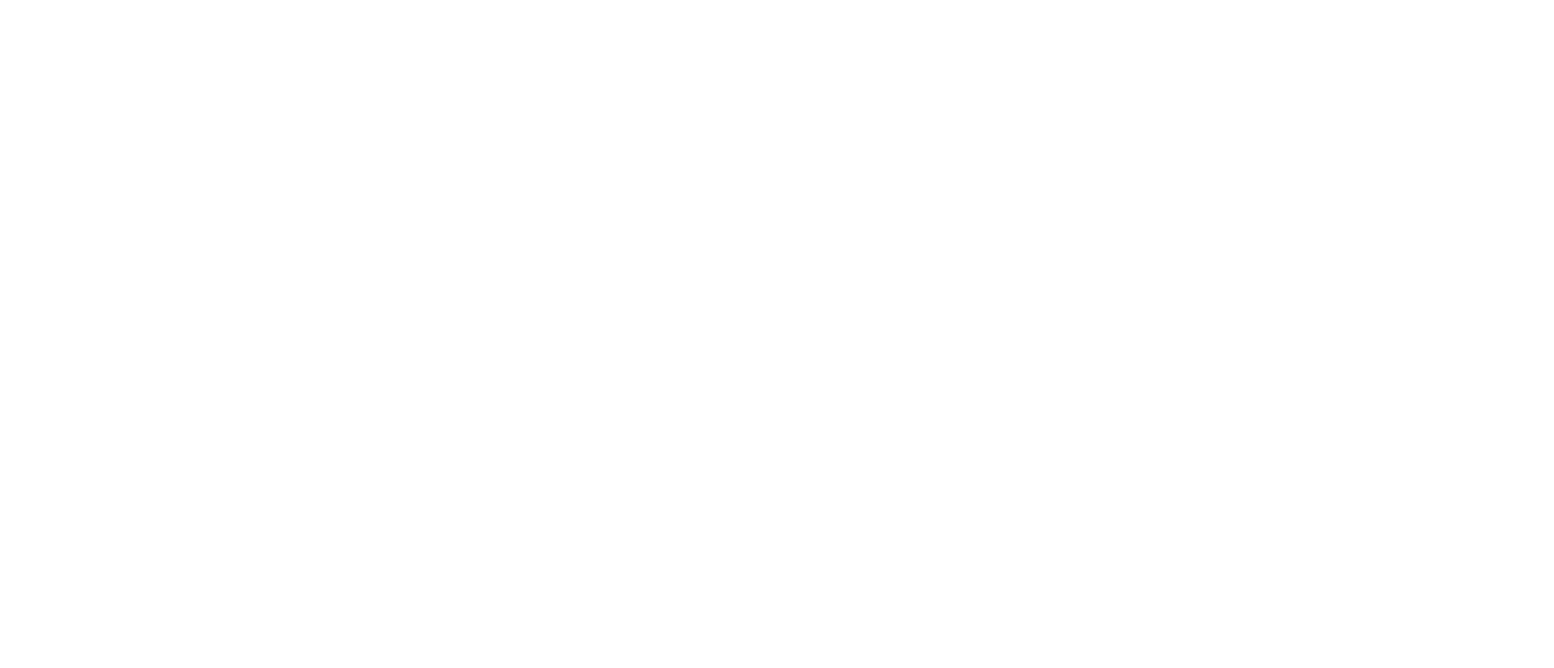Voix et représentations dans la presse quotidienne nationale
Résumé
Il s'agit de décrire les différentes formes d'inscription des discours dans la presse quotidienne nationale et de s'interroger sur les représentations mise en jeu au croisement de ces "discours représentés" : car "les voix" qui se rencontrent dans l'espace du journal viennent souvent d'autres lieux que l'espace du journal et renvoient de ce fait à des domaines de mémoire reliés à la culture et à l'histoire. À partir d'une définition du dialogisme qui réfère à cette "capacité de l'énoncé à faire entendre, outre la voix de l'énonciateur, une (ou plusieurs) autre(s) voix qui le feuillette(nt ) énonciativement " (Bres, Siblot, Vérine 2001), on peut conduire une analyse qui s'appuie sur différents types d'observables dont certains surgissent à l'insu de l'énonciateur mais qui participent tout autant à la construction de la réalité sociale. Dans une première partie, sont ainsi décrits des formes d'intertexte à plusieurs voix, qui s'avèrent plus ou moins "bruyantes", des formes qui accentuent la clandestinité des discours transverses (comme certains préconstruits), des formes qui renvoient à une mémoire discursive plus ou moins enfouie. La deuxième partie s'interroge sur les fonctions et les effets des différentes voix "représentées" : une fonction de crédibitlité ? une façon de représenter l'événement ? Une manière de construire l'opinion ? La mise au jour des représentations conduit à entrevoir comment ces fonctionnements discursifs semblent participer à la construction d'une "culture discursive" (von Münchow 2008) et aux discours fondateurs des sociétés contemporaines.
Origine : Fichiers produits par l'(les) auteur(s)
Loading...